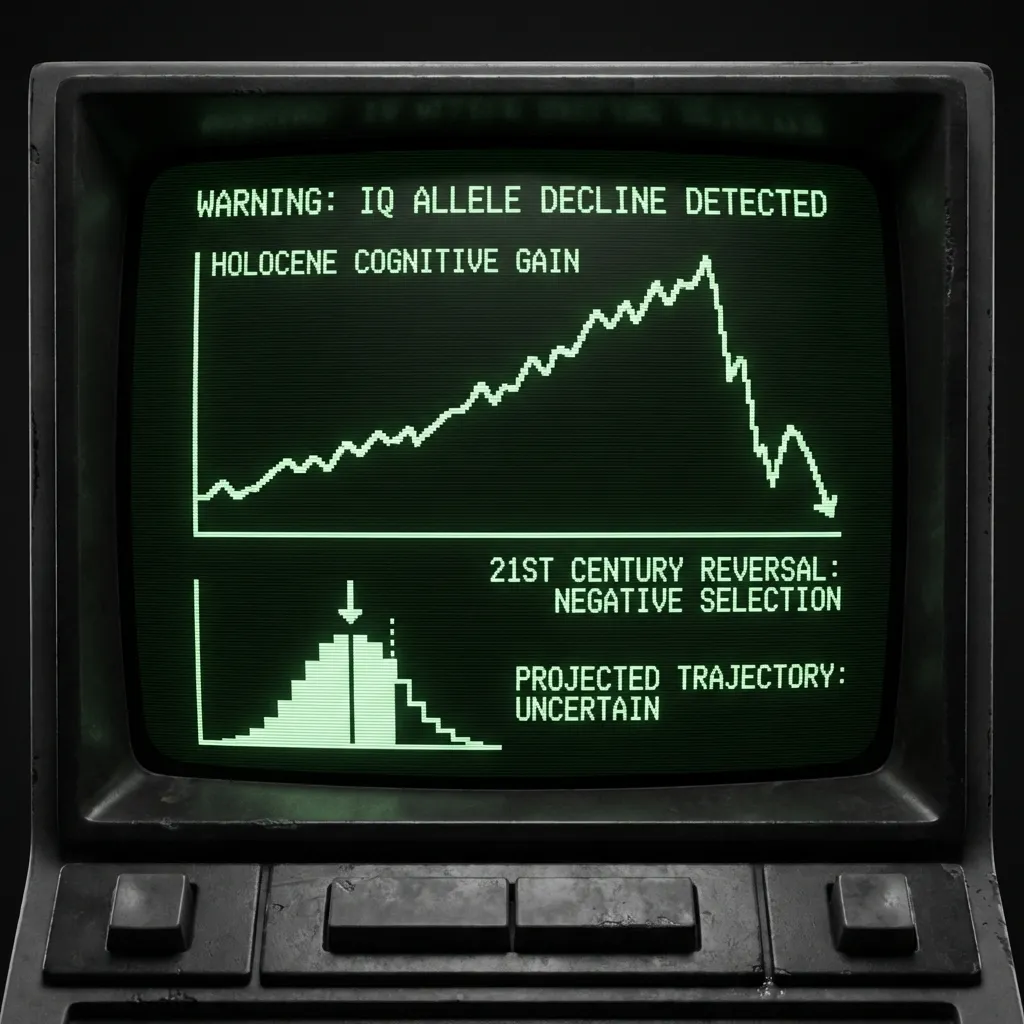TL;DR
- Les séries temporelles d’ADN ancien montrent une augmentation d’environ 0,5 écart-type des scores polygéniques pour le QI/la réussite éducative depuis le Néolithique.
- Les tendances convergent à travers l’Eurasie occidentale, l’Asie de l’Est et d’autres régions, tandis que les allèles pour le névrosisme/la dépression ont diminué.
- L’équation du sélectionneur explique comment une sélection faible par génération se cumule en changements importants sur plus de 10 000 ans.
- Les ensembles de données modernes révèlent une inversion récente (sélection négative sur les allèles du QI), prouvant que l’évolution cognitive humaine est en cours.
- Les affirmations selon lesquelles “rien n’a changé génétiquement dans l’esprit humain depuis 50 000 ans” sont en contradiction avec les preuves génomiques et génétiques quantitatives.
⸻
ADN ancien : Signaux mondiaux de sélection cognitive (2023–2025)#
Les études récentes sur les génomes anciens confirment une sélection directionnelle substantielle sur les traits liés à l’intelligence tout au long de l’Holocène. En utilisant des scores polygéniques de séries temporelles (PGS) – indices de propension génétique pour des traits complexes – les chercheurs ont suivi les changements de fréquence des allèles chez des milliers d’individus anciens. L’image qui émerge est que les allèles associés à des capacités cognitives plus élevées ont constamment augmenté en fréquence au cours des ~10 000–12 000 dernières années dans de nombreuses populations humaines :
- Eurasie occidentale : Une étude de 2024 sur ~2 500 génomes anciens d’Europe et du Proche-Orient a trouvé une “sélection directionnelle positive pour la réussite éducative (EA), le QI et les traits de statut socio-économique (SES) au cours des 12 000 dernières années.” Les scores polygéniques pour l’EA et le QI ont augmenté de manière marquée depuis le Paléolithique supérieur jusqu’à l’ère néolithique, suggérant que les exigences cognitives de l’agriculture précoce et de l’urbanisation ont exercé une pression de sélection sur l’intelligence générale. De manière intrigante, les scores polygéniques pour le névrosisme et la dépression montrent une diminution au fil du temps, probablement parce que les allèles prédisposant à une plus grande stabilité mentale ont accompagné ceux améliorant la capacité de résolution de problèmes (étant donné les corrélations génétiques entre ces traits). En d’autres termes, à mesure que les gènes pour une cognition plus élevée augmentaient, les gènes liés à l’affect négatif avaient tendance à être purgés comme effet secondaire.
- Eurasie orientale : Des résultats parallèles proviennent d’une analyse de 2025 de 1 245 génomes anciens couvrant l’Asie holocène. Elle a également “observé des tendances temporelles significatives” avec une sélection positive sur les traits cognitifs – notamment les allèles pour un QI et une EA plus élevés – à travers la préhistoire de l’Eurasie orientale. La même étude a trouvé que ces tendances étaient robustes même après avoir contrôlé les changements démographiques (en utilisant des covariables d’admixture et géographiques). Fait intéressant, elle a rapporté que les allèles associés aux traits du spectre autistique ont augmenté (réflétant potentiellement une amélioration de la systématisation ou de l’attention aux détails), tandis que ceux pour l’anxiété et la dépression ont diminué, reflétant le schéma européen. La sélection sur la taille était plus dépendante du contexte, variant de manière non linéaire avec le climat – mais l’augmentation constante des variantes liées à l’éducation/QI suggère une réponse évolutive large et convergente dans les sociétés subissant des transitions néolithiques.
- Europe (réplication grand public) : Une étude de 2022 par Kuijpers et al. a assemblé des PGS à l’échelle du génome pour divers traits chez les Européens anciens, corroborant que “après le Néolithique, les populations européennes ont connu une augmentation des scores de taille et d’intelligence,” ainsi qu’une diminution de la pigmentation de la peau. Cette étude de Frontiers in Genetics a utilisé des indices polygéniques basés sur les GWAS pour l’intelligence et a trouvé une tendance soutenue à la hausse du potentiel cognitif à partir d’environ 8 000 ans. Notamment, cela s’aligne avec le dossier archéologique : la Révolution néolithique et la complexité sociétale subséquente ont créé de nouvelles niches où la capacité cognitive générale (GCA) était fortement récompensée.
- Scans de sélection de séries temporelles directes : Fin 2024, une équipe dirigée par Akbari et al. (incluant David Reich) a introduit un test de sélection d’ADN ancien puissant recherchant des tendances cohérentes de fréquence des allèles au fil du temps. En l’appliquant à 8 433 anciens Eurasiens occidentaux (14 000–1 000 BP), ils ont identifié un “ordre de grandeur de plus” de signaux de sélection que les méthodes antérieures – environ 347 loci avec >99% de probabilité postérieure de sélection. Aux côtés des adaptations classiques (par exemple, la persistance de la lactase), ils ont trouvé des preuves polygéniques de sélection directionnelle sur les traits liés à la cognition. En particulier, les auteurs rapportent que “des combinaisons d’allèles qui sont aujourd’hui associées à… des mesures accrues liées à la performance cognitive (scores aux tests d’intelligence, revenu des ménages et années de scolarité)” ont connu une augmentation coordonnée de fréquence au cours de l’Holocène. Par exemple, les allèles améliorant la réussite éducative semblent avoir été poussés vers le haut par une forte sélection chez les Eurasiens occidentaux, surtout après environ 5 000 BP. Ces découvertes renforcent les indices antérieurs de l’ADN ancien selon lesquels nos ancêtres ont connu des améliorations génétiques continues des capacités d’apprentissage et de résolution de problèmes – même si le phénotype historique exact (par exemple, meilleure mémoire, innovation ou cognition sociale) est inféré indirectement.
- Taille du cerveau et traits connexes : Il convient de noter que la sélection sur l’intelligence ne signifie pas toujours la sélection sur le volume cérébral en soi. Paradoxalement, le cerveau humain a légèrement diminué en taille depuis le Pléistocène tardif. L’analyse des tendances polygéniques confirme une légère diminution de la propension génétique à un volume intracrânien plus grand (ICV) du Paléolithique supérieur aux millénaires récents. Cela reflète probablement des compromis énergétiques ou une auto-domestication (des cerveaux plus petits et plus efficaces) plutôt qu’une dégradation cognitive. En effet, le PGS de l’ICV en Europe montre seulement une petite corrélation négative avec l’âge (r ≈ –0,08 sur 12 000 ans) et pas de changements brusques – cohérent avec les données fossiles montrant une réduction d’environ 10% de la capacité crânienne moyenne des chasseurs-cueilleurs de l’ère glaciaire aux humains modernes. En bref, nos cerveaux ont peut-être légèrement rétréci mais sont devenus plus “optimisés pour le câblage,” tandis que le cadran génétique sur la capacité cognitive a encore progressé par d’autres voies (par exemple, la plasticité synaptique, les gènes de neurotransmission, le développement du cortex frontal, etc.). De manière révélatrice, certains des balayages les plus forts de l’Holocène ont eu lieu à des loci liés au développement neural. Par exemple, le chromosome X montre des preuves de balayages sélectifs dramatiques au cours des ~50–60 000 dernières années près de gènes comme TENM1, qui est impliqué dans la connectivité cérébrale ; les chercheurs spéculent que cela pourrait refléter une adaptation dans des facultés comme le langage (récursion phonologique) ou la cognition sociale chez Homo sapiens après avoir divergé des humains archaïques. En somme, l’ADN ancien livre une réfutation retentissante de l’idée que “rien n’a changé” génétiquement dans l’esprit humain – au contraire, de nombreux petits ajustements alléliques se sont accumulés pour produire des changements non triviaux dans la boîte à outils cognitive de notre espèce au cours de l’Holocène.
Les contre-arguments du “Pas d’évolution cognitive” (et pourquoi ils échouent)#
Il a longtemps été un article de foi anthropologique que la cognition humaine a atteint un pic de modernité comportementale il y a environ 50 000 ans, sans changement biologique significatif depuis. Stephen Jay Gould a fameusement affirmé qu’“il n’y a eu aucun changement biologique chez les humains depuis 40 000 ou 50 000 ans. Tout ce que nous appelons culture et civilisation, nous l’avons construit avec le même corps et le même cerveau.” De même, le scientifique cognitif David Deutsch a récemment affirmé que les peuples préhistoriques étaient “nos égaux en capacité mentale ; la différence est purement culturelle.” Ce catéchisme de la table rase – la notion que l’évolution s’est miraculeusement arrêtée pour le cerveau humain tout en continuant à plein régime pour des traits comme la résistance aux maladies ou la pigmentation – est maintenant directement contredit par les preuves. Examinons les principaux contre-arguments et pourquoi ils ne tiennent plus :
- “Les humains n’ont pas eu le temps d’évoluer cognitivement ; 50 000 ans, c’est trop court.” Cet argument sous-estime le pouvoir d’une sélection même faible sur de nombreuses générations. À titre d’expérience de pensée, considérez qu’un différentiel de sélection soutenu de seulement +1 point de QI par génération (bien en dessous du bruit des tests de QI) déplacerait, avec une héritabilité d’environ 0,5, la moyenne de ~+0,5 QI par génération. En 400 générations (≈10 000 ans), cela représente +200 points de QI – évidemment une extrapolation absurde. Le point est que, à moins que la sélection n’ait littéralement été nulle à chaque génération (une coïncidence extrêmement improbable), même une pression persistante minuscule pourrait produire un changement significatif sur des dizaines de millénaires. Ceux qui insistent sur “aucun changement depuis le Pléistocène” affirment essentiellement que pendant plus de 2 000 générations, l’intelligence n’a conféré aucun avantage reproductif. Pour le dire crûment, le seul monde dans lequel le cerveau de nos ancêtres s’est figé il y a 50 000 ans est celui où l’intelligence n’a apporté aucun bénéfice de fitness – un monde que ni chasseur-cueilleur ni agriculteur ne reconnaîtrait. Réaliste, une capacité cognitive plus élevée aide les humains à résoudre des problèmes, à acquérir des ressources et à naviguer dans des complexités sociales ; il est peu plausible qu’un tel trait soit neutre sur le plan évolutif dans tous les environnements. Les résultats des génomes anciens (Section 1) montrent de manière décisive qu’il n’était pas neutre, mais sous sélection positive chaque fois que des défis socio-écologiques récompensaient l’apprentissage, la planification et l’innovation.
- “Toutes les différences dans les résultats cognitifs sont dues à la culture, pas aux gènes.” Les évolutionnistes culturels soulignent à juste titre que la culture cumulative peut augmenter considérablement la performance humaine sans changement génétique – par exemple, la scolarisation généralisée peut augmenter les connaissances et les scores aux tests dans une population (l’effet Flynn). Cependant, l’évolution culturelle et génétique ne sont pas mutuellement exclusives ; en fait, elles coopèrent souvent. La culture peut créer de nouvelles pressions de sélection : par exemple, la culture de l’élevage laitier a sélectionné les gènes de la lactase, et de même, le passage à une société agraire complexe a probablement sélectionné des gènes aidant à la pensée abstraite, au contrôle de soi et à la planification à long terme. Comme le note l’anthropologue Joseph Henrich, “l’évolution génétique s’est accélérée au cours des 10 000 dernières années… en réponse à un environnement construit culturellement.” Nos génomes se sont adaptés à l’agriculture, à la haute densité de population, aux nouveaux régimes alimentaires et aux maladies – pourquoi ne s’adapteraient-ils pas aussi aux nouvelles exigences cognitives de ces environnements ? La culture amortit certaines pressions sélectives mais en amplifie d’autres (par exemple, la valeur de la numératie et de l’alphabétisation dans les sociétés complexes crée un avantage de fitness pour ceux qui apprennent rapidement). En effet, la théorie de la coévolution gène-culture prédit que des traits comme l’intelligence générale continueraient d’évoluer en réponse à des défis nouveaux. Les données empiriques le confirment maintenant : les populations ayant de longues traditions de sociétés denses et technologiquement avancées montrent des fréquences plus élevées d’allèles liés à la réussite éducative que les chasseurs-cueilleurs récemment contactés. La culture et les gènes ont grimpé ensemble – une boucle de rétroaction, pas un choix binaire.
- “Les peuples préhistoriques étaient tout aussi intelligents – regardez l’ancienne créativité et les outils.” Il ne fait aucun doute que les humains il y a 40 000 ans étaient intelligents dans un sens absolu (ils étaient biologiquement Homo sapiens après tout). Mais la question scientifique est celle des moyennes et des changements incrémentaux, pas un binaire “intelligent vs stupide.” Les critiques pointent souvent des artefacts symboliques précoces (par exemple, pigments d’ocre, perles d’environ 100 kya) comme preuve que la sophistication cognitive était présente bien avant 50 kya. Cependant, ces découvertes isolées sont débattues – de nombreux archéologues les voient comme des précurseurs ténus, avec une véritable explosion d’innovation (art rupestre, sculpture, outils complexes) n’apparaissant que dans le Paléolithique supérieur (~50–40 kya). Ce schéma suggère un événement seuil – peut-être une mise à niveau cognitive biologique (parfois hypothétisée comme une mutation génétique affectant le câblage cérébral ou le langage). Si tel est le cas, alors c’est en fait un cas pour l’évolution récente : un changement héréditaire pourrait avoir permis le “Grand Bond en Avant” dans la culture. Plus généralement, bien que les individus anciens aient certainement été capables, cela ne signifie pas que toutes les populations à tous les moments avaient un potentiel génétique identique. L’évolution ne s’arrête pas à une ligne d’arrivée de “comportement humain moderne.” Par exemple, il est révélateur que les premières civilisations et langues écrites soient apparues dans certaines régions (Croissant fertile, fleuve Jaune, etc.) après des millénaires d’agriculture – précisément les populations que nos données génétiques montrent avoir eu la plus forte sélection pour les allèles EA/QI. Cela ne signifie pas que ces premiers agriculteurs étaient intrinsèquement plus intelligents que les chasseurs-cueilleurs ailleurs – cela signifie qu’ils avaient commencé à devenir un peu plus intelligents grâce à l’évolution en tandem avec leur avance culturelle. Nous avons maintenant des transects de temps d’ADN ancien montrant que les PGS cognitifs sont restés plats dans les populations purement chasseurs-cueilleurs pendant des millénaires, mais ont commencé à grimper une fois que l’agriculture et les sociétés de niveau étatique ont émergé. En essence, l’évolution cognitive humaine a continué, modestement mais mesurablement, partout où la complexité culturelle a augmenté.
- “La taille du cerveau a en fait diminué ; cela n’implique-t-il pas moins d’intelligence ?” Il est vrai que le volume cérébral moyen d’Homo sapiens aujourd’hui (~1350 cc) est inférieur à celui des personnes du Paléolithique supérieur (~1500 cc). Certains anthropologues soutiennent que cela indique un processus d’auto-domestication nous rendant plus dociles et peut-être plus stupides (nous comparant à des animaux domestiqués avec des cerveaux plus petits que leurs homologues sauvages). Pourtant, la taille du cerveau n’est que faiblement corrélée avec le QI (chez les humains modernes, la corrélation est d’environ ~0,3–0,4). La qualité et l’organisation des circuits neuronaux comptent davantage. Il est tout à fait plausible que nos cerveaux soient devenus plus maigres mais plus efficaces – peut-être reflétant un passage de la prouesse visuospatiale brute à des réseaux corticaux plus spécialisés pour la cognition complexe. Les preuves génétiques soutiennent cette interprétation : malgré une légère diminution holocène du volume crânien, les allèles améliorant la fonction cognitive augmentaient. Par exemple, un scan de génome ancien note que de nombreux gènes de développement cérébral (au-delà des seuls régulateurs de la taille de la tête) étaient sous sélection. Nous pourrions le comparer à des puces informatiques : notre “matériel” est devenu plus petit à certains égards, mais notre “logiciel” (connectivité neuronale et réglage des neurotransmetteurs) a été amélioré. De plus, un cerveau plus petit dans un contexte domestiqué et coopératif pourrait réduire la consommation d’énergie et les risques d’accouchement tout en augmentant l’intelligence sociale. Dans tous les cas, la réduction modeste du PGS de l’ICV (de l’ordre de 0,1 écart-type sur 10 000 ans) n’a clairement pas empêché l’augmentation des capacités cognitives. C’est un compromis évolutif nuancé, pas simplement un déclin. (Et comme contre-argument humoristique : si l’on pense vraiment que nous sommes tous devenus plus stupides depuis l’ère glaciaire, il faut alors admettre que le cerveau a été soumis à un changement génétique – sapant ainsi l’affirmation centrale de “pas d’évolution” pour commencer.)
- “Les résultats différentiels aujourd’hui sont entièrement environnementaux, donc la génétique ne peut pas être impliquée.” Cet argument découle souvent d’une prudence louable contre le déterminisme génétique, mais il confond la variation actuelle avec le changement historique. Oui, le fait que (par exemple) les taux d’alphabétisation diffèrent en raison de l’accès à l’éducation ne dit rien sur le fait que les gènes ont changé au cours des siècles. On peut pleinement reconnaître le rôle massif de l’environnement (l’effet Flynn a augmenté les scores de QI de >2 écart-types dans de nombreux pays grâce à l’éducation, la nutrition, etc.) tout en reconnaissant les tendances sous-jacentes de la fréquence des gènes. En fait, les observations modernes présentent un avertissement sévère : le phénotype et le génotype peuvent évoluer dans des directions opposées. Exemple concret – au 20e siècle, le QI mesuré dans les pays développés a augmenté (effet Flynn) même si la sélection génétique était contre un QI plus élevé (en raison de la fertilité différentielle). Une analyse récente des données de santé et de retraite des États-Unis estime que la sélection génétique a abaissé le score polygénique cognitif de la population d’environ 0,04 écart-type par génération au milieu du 20e siècle – équivalent à environ –0,6 point de QI par génération perdu en raison de tendances dysgéniques, même si les scores réels aux tests ont augmenté grâce aux améliorations environnementales. En d’autres termes, la culture peut masquer ou l’emporter sur la génétique à court terme. Mais sur des centaines de générations, si la sélection favorise ou défavorise systématiquement certains allèles, le signal génétique finira par se manifester. Rejeter l’évolution à long terme en pointant les effets environnementaux à court terme est un non-sequitur. Les deux facteurs ont été à l’œuvre : l’environnement façonne l’expression de l’intelligence, tandis que l’évolution a lentement mais sûrement façonné la distribution des gènes favorisant l’intelligence.
En résumé, la position anthropologique enracinée selon laquelle “rien n’a changé depuis l’âge de pierre” est intenable à la lumière des preuves modernes. Cette position a persisté davantage comme un engagement idéologique envers l’égalité humaine et l’exceptionnalisme qu’une hypothèse testable – elle a survécu, comme l’a dit un commentateur, “par décret, pas par données.” Aujourd’hui, nous avons les données. Les génomes anciens, les scans de sélection et la génétique quantitative ont convergé pour révéler que l’évolution cognitive humaine a continué dans l’Holocène et même l’ère historique. Les changements étaient incrémentaux, ne transformant pas nos ancêtres en idiots (ils étaient clairement assez intelligents pour survivre et innover), mais ils étaient directionnels – réfutant l’idée d’un paysage intellectuel plat figé dans le temps.
L’équation du sélectionneur, les seuils et le changement à long terme#
L’équation du sélectionneur de la génétique quantitative fournit une lentille simple pour quantifier combien de changement évolutif nous attendons dans un trait sous sélection. Elle énonce :
[\Delta Z = h^2 , S]
où ΔZ est le changement de la moyenne du trait par génération, h² est l’héritabilité du trait, et S est le différentiel de sélection (la différence de la moyenne du trait entre les individus se reproduisant et la population globale). Cette formule élégante – essentiellement une prévision en une étape de la réponse à la sélection – a des implications profondes lorsqu’elle est étendue sur de nombreuses générations, en particulier pour un trait hautement polygénique comme l’intelligence.
Décomposons-la dans le contexte des traits cognitifs humains :
- Même une sélection faible peut avoir de grands effets avec suffisamment de temps. Supposons qu’une population ait un différentiel de sélection positif très modeste sur l’intelligence – disons que les parents sont en moyenne juste 0,1 écart-type (environ 1,5 point de QI) au-dessus de la moyenne de la population. Même avec une héritabilité modérée de 0,5, chaque génération la moyenne du QI se déplacerait de ΔZ = 0,5 * 0,1 = 0,05 écart-type (~0,75 point de QI). Cela semble négligeable – à peine perceptible en une génération. Mais cumulez-le sur 100 générations (≈2 500 ans) : si l’environnement et le régime de sélection restaient à peu près constants, vous accumuleriez ~5 écart-types de changement (0,05 * 100) – c’est-à-dire une augmentation de 75 points de QI ! Bien sûr, en réalité, les forces de sélection fluctuent ; il pourrait aussi y avoir des compromis limitant le changement indéfini. Mais l’idée centrale est que l’inertie évolutive est un mythe – de petites poussées directionnelles, si elles sont soutenues, conduisent à des résultats très importants. Notre période de 50 000 ans englobe ~2 000 générations humaines. C’est amplement suffisant pour une évolution cognitive significative, même sous des pressions sélectives douces.
- La sélection inversée peut également éroder les gains. Les mêmes mathématiques s’appliquent dans la direction opposée. Comme mentionné ci-dessus, au 20e siècle, le différentiel de sélection sur l’éducation/QI est devenu négatif dans de nombreuses sociétés (en raison d’une combinaison de facteurs comme la fertilité plus faible des individus hautement éduqués). Les estimations des données génomiques aux États-Unis suggèrent S ≈ –0,1 écart-type pour l’EA dans les générations récentes, ce qui implique ΔZ ≈ –0,05 écart-type par génération génotypiquement. Sur seulement 10 générations (~250 ans), cela s’accumulerait à un changement de –0,5 écart-type, annulant peut-être ~7 ou 8 points de QI de potentiel génétique. Ce n’est pas simplement hypothétique – c’est une trajectoire sur laquelle nous sommes empiriquement. L’équation du sélectionneur prédit donc non seulement la montée rapide d’un trait sous sélection positive, mais aussi son déclin sous relaxation ou inversion de la sélection. Cette dualité est cruciale pour interpréter le passé. Si l’on soutient qu’aucune évolution cognitive n’a eu lieu dans la préhistoire, on exige implicitement que la sélection ait été parfaitement nulle ou symétriquement fluctuante pour s’annuler sur des milliers de générations – une coïncidence extraordinaire. Étant donné la rapidité avec laquelle nous pouvons déjà détecter les déclins génétiques du QI dans les deux dernières générations, il serait spécial de supposer que la sélection préhistorique n’a jamais une fois penché positivement pour le QI. Au contraire, elle a probablement souvent penché positivement (par exemple, lorsque des individus plus intelligents ont mieux survécu à des périodes difficiles ou ont atteint un statut plus élevé dans des sociétés stratifiées), produisant la tendance génétique à la hausse maintenant enregistrée dans l’ADN ancien.
- Modèles de seuils et sauts non linéaires : Une nuance souvent soulevée est que certaines capacités cognitives pourraient se comporter comme des traits de seuil – vous avez soit “assez” de certains circuits neuronaux pour soutenir une capacité, soit vous ne l’avez pas. Le langage est un exemple classique argumenté dans ce sens : peut-être que des augmentations incrémentales de l’intelligence générale font peu jusqu’à ce qu’un seuil soit franchi qui permet la récursion syntaxique ou la véritable pensée symbolique, à quel point le phénotype change qualitativement (un “changement de phase”). Si de tels seuils existent, la sélection peut avoir des effets non linéaires. Une population pourrait voir relativement peu de changement apparent pendant des générations, puis une floraison soudaine de nouveaux comportements une fois que l’accumulation génétique pousse le trait au-delà du point critique. Le “paradoxe sapient” archéologique – l’écart entre les humains anatomiquement modernes ~200 kya et l’explosion culturelle ~50 kya – pourrait refléter cette dynamique. Un déplacement de +5 écart-types dans un trait cognitif de seuil n’est pas simplement “plus de la même chose” – cela peut signifier la différence entre aucune langue écrite et l’invention spontanée de systèmes d’écriture, ou entre la stagnation de l’âge de pierre et une révolution industrielle. Cette perspective réfute l’affirmation selon laquelle quelques écarts-types de changement génétique sont sans importance. En fait, une augmentation calculée de +0,5 écart-type dans le PGS cognitif depuis le début de l’Holocène, si elle est mappée sur certaines capacités sous-jacentes, pourrait avoir été la différence entre un monde avec seulement des villages agricoles clairsemés et un monde grouillant de civilisations. En bref, de petits changements génétiques peuvent amorcer de grandes percées culturelles une fois les seuils franchis. L’évolution humaine est probablement un mélange de tendances graduelles et de ces événements de basculement.
- Version multivariée de Lande – réponses corrélées : L’équation du sélectionneur se généralise à plusieurs traits via l’équation de Lande, (\Delta \mathbf{z} = \mathbf{G} \boldsymbol{\beta}), où G est la matrice de covariance génétique et β est le vecteur des gradients de sélection sur chaque trait. La principale conclusion est que vous pouvez obtenir une réponse dans le trait Z sans sélectionner directement sur Z du tout, si Z est génétiquement corrélé avec un trait X qui est sous sélection. Appliquez cela à l’intelligence : même si nos ancêtres n’étaient pas explicitement “en train d’essayer” de devenir plus intelligents, la sélection sur des proxys ou des corrélats pourrait l’avoir fait indirectement. Par exemple, considérez le statut social ou la richesse dans une société complexe. Si les individus à QI plus élevé avaient tendance (en moyenne) à atteindre un statut plus élevé ou à accumuler plus de ressources, et que ces individus avaient plus de descendants, alors les gènes pour l’intelligence seraient entraînés par la sélection sur le succès social. C’est essentiellement la thèse de Gregory Clark dans A Farewell to Alms (2007) – que dans l’Angleterre médiévale, les personnes économiquement réussies (qui étaient, selon son argument, plus prudentes, éduquées et peut-être plus aptes cognitivement) ont surpassé les pauvres en reproduction, déplaçant progressivement les traits de la population. Nous avons maintenant des preuves génétiques soutenant ce type de réponse corrélée : dans une analyse récente de génomes anciens d’Angleterre (1000–1850 CE), les scores polygéniques pour la réussite éducative ont significativement augmenté au cours de ces siècles, impliquant une sélection génétique favorisant les traits qui rendaient une personne réussie dans cette société. Il est important de noter que ce n’est pas que les paysans médiévaux choisissaient des partenaires pour le QI ; plutôt, la sélection opérait via les résultats de la vie (alphabétisation, richesse, fécondité), qui se trouvaient être génétiquement corrélés avec la capacité cognitive. De même, la sélection pour la résistance aux maladies ou d’autres traits de fitness pourrait avoir des effets cognitifs accidentels. (Il y a des preuves, par exemple, que les allèles de risque de schizophrénie ont pu être sélectionnés contre parce qu’ils réduisent la fitness biologique globale, et comme ceux-ci se chevauchent génétiquement avec la fonction cognitive, leur élimination pousse la capacité cognitive moyenne vers le haut.) En génétique évolutive, chaque trait connecté dans le réseau peut bouger si n’importe quelle partie du réseau est tirée. Les gènes de l’intelligence humaine n’ont pas évolué isolément ; ils ont profité des nombreuses forces sélectives – de l’adaptation au climat à la sélection sexuelle pour certaines personnalités – toutes filtrées à travers la structure de covariance génétique. Le résultat final a été une marche régulière dans notre indice polygénique cognitif, même si “rendre les cerveaux plus intelligents” n’a jamais été la seule cible de la sélection.
Pour ancrer cela en chiffres, considérons ce que l’ADN ancien nous révèle. Les scores polygéniques pour la capacité cognitive (utilisant les résultats GWAS pour le QI/EA) ont augmenté de l’ordre de 0,5 écart-type depuis le début de l’Holocène jusqu’à aujourd’hui. Si l’on suppose (généreusement) que ces scores expliquent, disons, ~10 % de la variance du trait réel, une augmentation génotypique de 0,5 SD pourrait se traduire par une augmentation phénotypique d’environ ~0,16 SD (une approximation grossière, puisque le véritable pouvoir prédictif des résultats actuels de GWAS pour le QI est dans cet ordre de grandeur). 0,16 SD correspond à environ 2,4 points de QI. Pas énorme – mais c’est par 10 000 ans. Sur 50 000 ans, si la tendance était constante, cela pourrait être de l’ordre de 12 points de QI. Fait intéressant, certains paléoanthropologues ont spéculé que les humains du Paléolithique supérieur (qui ont laissé derrière eux des outils relativement simplistes) pourraient effectivement avoir eu une capacité cognitive moyenne légèrement inférieure pour le raisonnement symbolique par rapport aux humains de l’Holocène ultérieur – une différence que vous ne remarqueriez pas dans les compétences de survie quotidienne, mais suffisante pour influencer le taux d’innovation. Que cette magnitude spécifique soit exacte ou non, l’équation du sélectionneur nous assure que de grands changements cumulatifs sont plausibles sous une sélection constante et faible, et les données de l’ADN ancien confirment désormais une trajectoire globalement en ligne avec les attentes théoriques (par exemple, un S de l’ordre de 0,2 point de QI par génération expliquerait parfaitement les changements à l’échelle du génome que nous observons sur ~400 générations).
Tendances de sélection modernes et leurs implications historiques#
L’étude de l’évolution en cours chez les humains contemporains offre un contrepoint sobre – et un indice sur les régimes passés. À la fin du 20e et au début du 21e siècle, la plupart des populations industrialisées ont connu une inversion de la sélection sur les traits cognitifs. Avec la contraception, l’amélioration de la survie des enfants et les changements de valeurs, la corrélation positive précédente entre intelligence et fertilité est devenue négative. Par exemple, une méta-analyse exhaustive de Lynn (1996) a trouvé une corrélation moyenne QI-fertilité d’environ –0,2 à travers des dizaines de jeux de données, impliquant environ –0,8 point de QI de sélection par génération contre g. Des approches génomiques plus directes soutiennent cela : Hugh-Jones et ses collègues (2024) ont examiné les scores polygéniques réels dans des familles américaines et ont rapporté que “les scores qui corrèlent positivement avec l’éducation sont sélectionnés négativement”, conduisant à un changement génétique estimé à –0,055 SD par génération en capacité cognitive. Cela se traduit par environ –0,6 point de QI perdu génétiquement chaque génération. Crucialement, ces résultats proviennent d’une période de soutien médical et social sans précédent – un environnement sélectif détendu par rapport aux normes historiques. Pourtant, même dans ce contexte confortable, la sélection naturelle au niveau génomique n’a pas disparu ; elle a simplement pris une autre tournure (favorisant les traits associés à une procréation plus précoce et à un niveau d’éducation inférieur).
Pourquoi cela importe-t-il pour le passé ? Parce que cela démontre que les populations humaines ne sont jamais vraiment à un équilibre évolutif neutre. La sélection se produit toujours sous une forme ou une autre, même si la société moderne en obscurcit les effets avec la technologie. Si, à l’époque la plus facile de l’existence humaine, nous pouvons mesurer un changement génétique directionnel en un siècle, à quel point la sélection aurait-elle pu être plus forte dans des époques plus difficiles ? Historiquement, une intelligence élevée peut avoir été une arme à double tranchant : elle pouvait aider à l’acquisition de ressources (augmentant la forme physique) mais aussi, dans certains contextes, comporter des compromis (peut-être une légère propension à des problèmes neurologiques ou psychiatriques). Dans les temps pré-modernes, cependant, l’équilibre semble avoir favorisé une cognition plus élevée plus souvent qu’autrement :
- Sélection positive historique (le cas de “l’élevage pour les cerveaux”) : De nombreux chercheurs ont souligné les modèles démographiques dans les sociétés agraires où les classes supérieures – souvent ayant un meilleur accès à la nutrition, à l’éducation, et peut-être avec des intellects moyens plus élevés – avaient plus de descendants survivants que les classes inférieures. L’analyse de Gregory Clark des lignées familiales anglaises (à partir de testaments et de registres) a montré que les économiquement prospères dans l’Angleterre médiévale avaient environ 2× le nombre d’enfants survivants par rapport aux pauvres, conduisant à une lente diffusion des gènes de la “classe moyenne” dans la population générale. Les traits sous sélection dans ce modèle incluaient la littératie, la prévoyance, la patience et les dispositions liées à la cognition (ce que Clark a appelé “le capital humain de la queue supérieure”). Les données génétiques renforcent maintenant ce récit. Une étude récente d’ADN ancien a spécifiquement testé l’hypothèse de Clark en examinant les scores polygéniques dans des restes de l’Angleterre médiévale et moderne. Les résultats : une “tendance temporelle positive statistiquement significative dans les scores polygéniques d’accomplissement éducatif” de 1000 CE à 1800 CE. L’ampleur de l’augmentation de ces scores génotypiques, bien que modeste, est “suffisamment grande pour servir de facteur contributif à la Révolution industrielle”. En termes plus simples, la population anglaise a progressé génétiquement dans des traits propices à l’apprentissage et à l’innovation, ce qui peut aider à expliquer pourquoi cette population était prête pour une explosion économique/culturelle sans précédent au 18e siècle. C’est une puissante validation de l’idée que la sélection naturelle ne s’est pas arrêtée au Paléolithique – elle façonnait les capacités cognitives jusqu’à la période moderne.
Scores polygéniques (PGS) pour les traits cognitifs et sociaux dans les génomes anglais médiévaux vs contemporains. Les boîtes jaunes (échantillons modernes) se situent systématiquement plus haut que les violettes (médiévales) pour les indices d’accomplissement éducatif (EA) et de QI, indiquant un changement génétique favorisant ces traits au cours des ~800 dernières années. De telles découvertes soutiennent empiriquement les théories selon lesquelles une sélection modeste dans les sociétés historiques s’est accumulée en différences appréciables.
- “Oscillations pendulaires” gène-culture : Le modèle au fil du temps pourrait être cyclique ou dépendant de l’environnement. Dans des conditions extrêmement difficiles (par exemple, la toundra de l’âge glaciaire ou les communautés de pionniers agricoles), la survie pouvait dépendre plus fortement de l’intelligence générale – la capacité d’inventer de nouveaux outils, de se souvenir des emplacements de nourriture, ou de planifier pour l’hiver – donc la sélection sur le QI était forte. Dans des périodes plus stables et prospères, d’autres facteurs (comme les alliances sociales ou la santé physique) pouvaient importer davantage, diluant la sélection sur le QI. Avançons rapidement jusqu’à l’ère post-industrielle, et nous voyons un scénario où les modes de vie axés sur l’éducation corrèlent en fait avec une production reproductive plus faible (pour des raisons socioculturelles), inversant la sélection de manière négative. Ce que cela suggère, c’est que la direction de la sélection sur les traits cognitifs n’a pas été uniforme dans le temps ou l’espace, mais la tendance globale à long terme était à la hausse, car pendant le long balayage de la préhistoire et de l’histoire ancienne, chaque innovation ou défi environnemental créait de nouveaux avantages pour des cerveaux plus grands ou de meilleurs esprits. Au moment où nous atteignons l’ère moderne, nous sommes dans un environnement nouveau (survie facile, planification familiale consciente) où cette tendance s’est inversée. Si nous pensons en termes de l’équation du sélectionneur sur toute la période de 50 000 ans, les premiers ~49 000 ans ont contribué à beaucoup de petits ΔZ positifs, et les derniers siècles pourraient contribuer à un petit ΔZ négatif. La somme nette est toujours positive en faveur d’une intelligence plus élevée par rapport à la base paléolithique.
- Charge génétique moderne vs optimisation passée : Un autre angle est de considérer la charge mutationnelle et le rôle de la sélection dans la purge des variantes délétères. Le génome humain accumule de nouvelles mutations à chaque génération, dont beaucoup sont neutres ou légèrement nuisibles. Une fraction affecte probablement négativement le neurodéveloppement. Dans les environnements à forte mortalité et forte sélection du passé, les individus avec des charges plus lourdes de mutations délétères (y compris celles nuisant à la fonction cérébrale) étaient peut-être moins susceptibles de survivre ou de se reproduire, maintenant ainsi la “qualité” génétique de la population pour l’intelligence élevée. Dans les populations modernes, la sélection relâchée permet à plus de charges mutationnelles de persister (une hypothèse pour expliquer la prévalence croissante de certains troubles). Cela pourrait signifier que les groupes anciens étaient génétiquement plus optimisés pour un monde difficile – ironiquement plus “aptes” au sens darwinien – alors qu’aujourd’hui nous portons plus d’allèles faiblement délétères (qui pourraient subtilement nuire au potentiel cognitif moyen). Des études génomiques ont effectivement trouvé des signaux cohérents avec une sélection purificatrice agissant sur les gènes liés à l’intelligence dans le passé (par exemple, les allèles qui réduisent la fonction cognitive tendent à être à faible fréquence, comme prévu si la sélection les éliminait). Cette perspective souligne que les pressions évolutives renforçaient probablement notre architecture cognitive tout au long de la préhistoire, éliminant les pires mutations et favorisant occasionnellement de nouvelles bénéfiques. Notre ère actuelle, en revanche, pourrait tolérer un fardeau croissant que la sélection avait l’habitude de contraindre. L’implication est que les humains préhistoriques pourraient avoir été plus proches de leur potentiel génétique théorique pour l’intelligence que nous ne commençons à l’être sous des conditions relâchées – une inversion qui ne fait que souligner à quel point l’hypothèse “sélection = 0” est peu naturelle.
Intégrant toutes les lignes de preuve : l’intelligence humaine a été et reste une cible mouvante. L’ADN ancien confirme la montée des scores polygéniques cognitifs sur des milliers d’années, tandis que les données modernes documentent une chute récente. Les deux tendances sont relativement faibles par génération – quelques dixièmes de pour cent de changement – mais à travers le temps profond, elles s’additionnent de manière décisive. Il est franchement étonnant que certains prétendent encore que nos esprits existent dans une bulle de stase évolutive, immunisée contre les forces qui ont façonné tous les autres aspects de la vie. La réalité est que nous sommes très largement un produit de ces forces. Le progrès culturel rapide de notre espèce au cours des 50 derniers millénaires n’était pas un phénomène purement culturel se produisant sur un substrat génétiquement inchangé ; c’était une marche coévolutionnaire. Chaque avancée a modifié notre paysage sélectif, auquel nos génomes se sont ensuite lentement adaptés, permettant d’autres avancées, et ainsi de suite.
En 2025, le verdict de la génétique des populations, de la génomique ancienne et de la biologie quantitative est rendu : les traits cognitifs humains ont évolué de manière mesurable dans le passé évolutif récent. La vision du “tableau blanc”, qui traitait le cerveau humain comme une constante depuis le Paléolithique supérieur, s’avère être une fiction polie – qui a pu être politiquement réconfortante, mais pas scientifiquement correcte. L’intelligence, comme tout autre trait complexe, a répondu à la sélection. L’équation du sélectionneur nous a appris théoriquement que 50 000 ans est amplement suffisant pour le changement ; maintenant l’ADN ancien nous a montré empiriquement que ce changement s’est produit. En un sens, cela ne devrait pas être surprenant – il aurait été bien plus surprenant qu’un trait aussi pertinent pour la forme physique que la capacité cognitive n’ait pas subi de sélection directionnelle lorsque les premiers humains ont fait face à de nouveaux défis (des climats de l’âge glaciaire à la vie agricole).
Qu’est-ce que cela signifie pour nous aujourd’hui ? Une implication est que la variation humaine des capacités cognitives (entre individus et populations) a probablement un signal d’histoire évolutive, et pas seulement un environnement récent, derrière elle – un sujet de grande sensibilité, mais qui doit être abordé avec honnêteté et nuance. Une autre implication est que les réalisations remarquables de notre espèce – art, science, civilisation – ont été construites sur une toile génétique lentement changeante. Si nous étions restés avec exactement le même “corps et cerveau” d’il y a 50 000 ans, il est discutable que l’ampleur de la civilisation moderne aurait été possible. Et en regardant vers l’avenir, alors que les pressions de sélection changent maintenant (ou même s’inversent), nous devons considérer la trajectoire génétique à long terme des traits qui nous importent. L’humain du futur sera-t-il génétiquement moins enclin à l’intelligence abstraite si les tendances actuelles se poursuivent, et si oui, comment la société pourrait-elle compenser ? Ce ne sont plus des questions de spéculation oisive, mais informées par des données réelles.
Pour conclure sur une note “straussienne” : reconnaître que l’évolution cognitive humaine est en cours (et a été récente) ne devrait pas être déstabilisant – c’est une affirmation de notre place dans la tapisserie de la nature. Loin de diminuer la dignité humaine, cela enrichit notre histoire : nos ancêtres n’étaient pas des remplaçants statiques pour nous, ils étaient des participants actifs dans la formation de ce que l’humanité deviendrait, via à la fois la culture et les gènes. La vérification de la réalité des 50 000 dernières années est que l’évolution ne s’est pas arrêtée lorsque la culture a commencé. Les humains ont fait la culture, la culture a fait l’évolution, et la danse continue. Le tableau blanc est sorti ; le Nombre (ou plutôt, le score polygénique) est entré. Nous évoluons toujours – et oui, cela inclut nos cerveaux.
Sources#
- Akbari, A. et al. (2024). “Pervasive findings of directional selection…ancient DNA…human adaptation.” (bioRxiv preprint) – Evidence of >300 loci under selection in West Eurasians, including polygenic shifts in cognitive performance traits.
- Piffer, D. & Kirkegaard, E. (2024). “Evolutionary Trends of Polygenic Scores in European Populations from the Paleolithic to Modern Times.” Twin Res. Hum. Genet. 27(1):30-49 – Reports rising PGS for IQ, EA, SES over 12kyr in Europe; cognitive scores +0.5 SD since Neolithic , along with declines in neuroticism/depression PGS due to genetic correlation with intelligence.
- Piffer, D. (2025). “Directional Selection…in Eastern Eurasia: Insights from Ancient DNA.” Twin Res. Hum. Genet. 28(1):1-20 – Finds parallel selection patterns in Asian populations: IQ and EA PGS increasing through the Holocene , negative selection on schizophrenia/anxiety, positive on autism (consistent with European results).
- Kuijpers, Y. et al. (2022). “Evolutionary trajectories of complex traits in European populations of modern humans.” Front. Genet. 13:833190 – Uses ancient genomes to show post-Neolithic increase in genetic height and intelligence, confirming continued selection on these polygenic traits.
- Hugh-Jones, D. & Edwards, T. (2024). “Natural Selection Across Three Generations of Americans.” Behav. Genet. 54(5):405-415 – Documents ongoing negative selection against EA/IQ alleles in the 20th-century US, estimating ~0.039 SD per generation decline in phenotypic IQ potential.
- Discover Magazine (2022) on Gould’s quote: “Human Evolution in the Modern Age” by A. Hurt – Cites Gould’s “no change in 50,000 years” claim and notes that most evolutionary biologists now disagree, pointing to examples of recent human adaptation.
- Henrich, J. (2021). Interview in Conversations with Tyler – Discusses cultural evolution and acknowledges gene-culture feedback, noting genetic evolution accelerated in large populations over last 10k years (e.g. selection for blue eyes, lactose tolerance).
- Clark, G. (2007). A Farewell to Alms. Princeton Univ. Press – Proposed the idea of differential reproduction in pre-industrial England leading to genetic changes (supported by Piffer & Connor 2025 preprint: genetic EA scores rose 1000–1850 CE in England ).
- Woodley of Menie, M. et al. (2017). “Holocene selection for variants associated with general cognitive ability.” (Twin Res. Hum. Genet. 20:271-280) – An earlier study comparing a small set of ancient genomes to modern, suggesting an increase in alleles linked to cognitive function over time, laying groundwork for larger analyses.
- Hawks, J. (2024). “Natural selection on the rise.” (John Hawks Blog) – Reviews new ancient DNA findings, including the Akbari et al. results, and emphasizes how these data confirm an acceleration of human evolution in the Holocene (as Hawks and coworkers predicted in 2007).